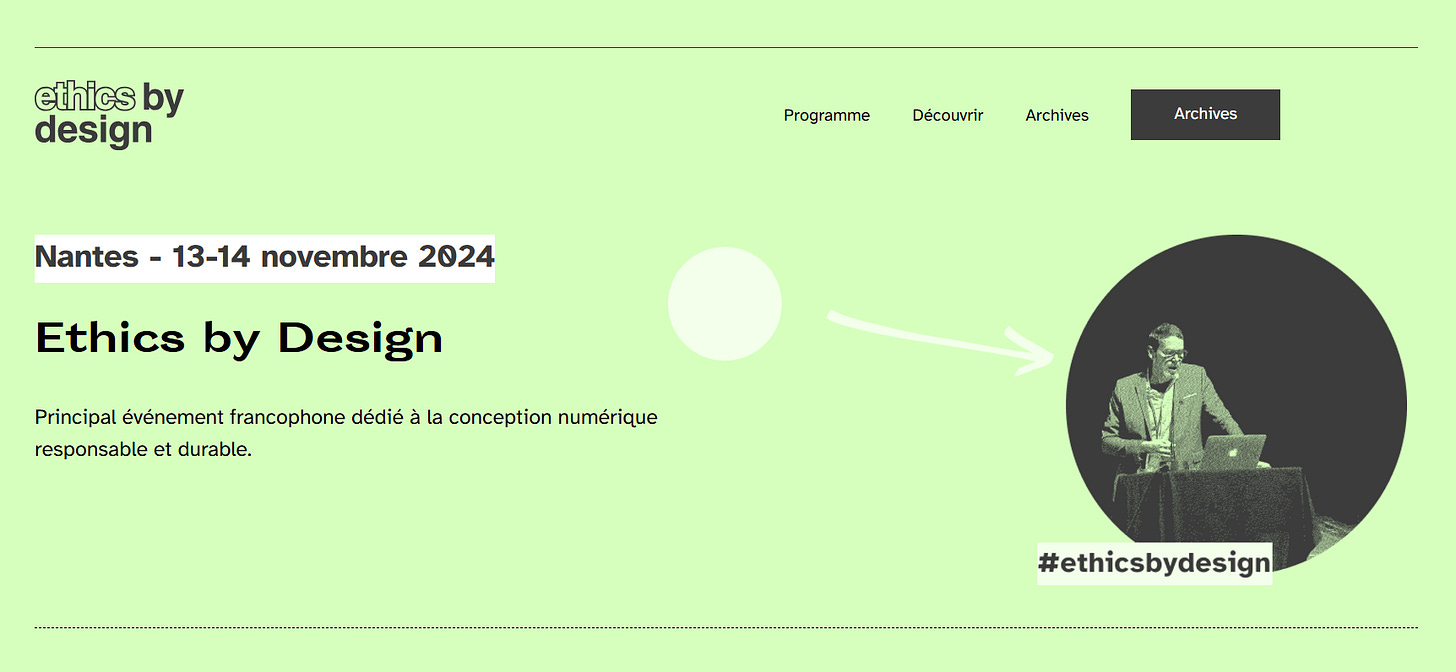Ethics by Design : faut-il arrêter de se raconter des belles histoires ?
Ou : quel rôle pour les designers et les acteurs du numérique dans un monde en transition, imaginer, projeter ou agir ?
Ethics by Design, qui s’est tenu il y a un peu plus d’une semaine à Nantes, est un évènement dédié au numérique et au design éthiques et responsables, et à la façon dont ces deux disciplines peuvent faire face aux grands enjeux environnementaux et sociétaux actuels.
La première journée de l’évènement – je n’ai malheureusement pu assister qu’à celle-ci – était entièrement consacrée à la question écologique. Quelle place pour le numérique face aux crises climatiques actuelles ? Quel rôle a notre société technologique dans le déclenchement de ces crises ? Le numérique fait-il partie du problème ou de la solution ? Et surtout, comment opérer et mettre en place un numérique plus responsable, dans notre quotidien ou via des projets plus structurants et ambitieux.
Comme on peut s’en douter, rien n’est réellement simple lorsque l’on touche à ces questionnements. Mais les thèmes abordés par Ethics by Design et ses organisateurs – le collectif des Designers Éthiques – vont bien plus loin qu’un simple questionnement méthodologique. Ils touchent à notre rôle-même en tant que professionnels du numérique, designers, créatifs ou décideurs. Explications.
4 SCÉNARIOS
Cette journée consacrée au numérique et à l’environnement suivait un fil rouge : les 4 scénarios que l’ADEME a imaginés, dessinant une France qui aurait atteint la neutralité carbone à l’horizon 2050, avec un objectif de réchauffement limité à +2,1° en 2100, ce qui n’est déjà pas si mal.
L’exercice, a été publié par l’organisation publique en novembre 2021 et présenté par Julia Meyer – ingénieure numérique responsable au sein de l’ADEME. Il imagine les grands changements de société nécessaires pour réduire le changement climatique et envisage pour cela plusieurs scénarios dans lesquels technologie, coopération, décroissance ou innovation ont des rôles différents : alors que le premier se base sur un changement de comportement global de notre société (mobilité douce, sobriété énergétique), le quatrième est clairement orienté autour du techno-solutionnisme et la course en avant technologique. Je reprends les mots de l’ADEME pour vous les expliquer :
Scénario n°1 : Génération frugale. Des transformations importantes dans les façons de se déplacer, de se chauffer, de s’alimenter, d’acheter et d’utiliser des équipements, permettent l’atteinte de la neutralité carbone sans impliquer de technologies de captage et stockage de carbone, non éprouvées et incertaines à grande échelle.
Scénario n°2 : Coopérations territoriales. La société se transforme dans le cadre d’une gouvernance partagée et de coopérations territoriales. Organisations non gouvernementales, institutions publiques, secteur privé et société civile trouvent des voies de coopération pragmatique qui permettent de maintenir la cohésion sociale.
Scénario n°3 : Technologies vertes. Le développement technologique permet de répondre aux défis environnementaux. Les métropoles se développent. Les technologies et le numérique, qui permettent l’efficacité énergétique, sont dans tous les secteurs. Les meilleures technologies sont déployées largement et accessibles de manière généralisée aux populations solvables.
Scénario n°4 : Pari réparateur. Les enjeux écologiques globaux sont perçus comme des contreparties du progrès économique et technologique : la société place sa confiance dans la capacité à gérer, voire à réparer, les systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières pour conserver un monde vivable.
Ces quatre scénarios sont bien entendu hypothétiques. Ce sont des imaginaires de travail. Ils laissent dans leurs réflexions quelques angles morts, comme ceux liés à la pénurie des ressources, aux droits humains ou au vivre-ensemble. Mais ils n’en restent pas moins une excellente base de travail et d’imagination sur l’impact écologique du numérique. Ils méritent toutefois une mise en contexte assez rapide sur ce qu’est réellement l’impact de nos usages numériques sur l’environnement.
Tout d’abord, il reste important de préciser – même si le fait commence à être reconnu – que l’impact du numérique sur le climat ne provient majoritairement de nos usages (e-mails, vidéos, etc.), mais bien de la production de matériel, qu’il s’agisse de nos terminaux, des infrastructures réseaux ou des datacenters. En ce sens, c’est principalement le renouvellement de nos appareils personnels – un nouveau smartphone tous les trois ans – et le développement à outrance d’infrastructures pour l’intelligence artificielle qui salent la note écologique du numérique. L’ADEME estime que sans changement de comportement, l’impact du numérique aura augmenté de 187% en ce qui concerne le C0₂ et de 59% en ce qui concerne la consommation de métaux à l’horizon 2050.
C’est pourquoi l’ensemble des scénarios de l’ADEME tablent sur une augmentation, en proportion variable, de l’empreinte écologique des outils technologiques, simplement pas à la même vitesse. Ainsi, les scénarios n°3 (Technologies vertes) et n°4 (Pari réparateur) voient une explosion de la production d’objets intelligents visant à tout traquer, tout mesurer, tout contrôler. Des scénarios qui rappellent certains des imaginaires majoritaires actuels : l’usage de puces connectées sur les animaux ou la multiplication des drones fait par exemple partie des projections du Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson.
Seul le scénario 1 de l’ADEME – Génération frugale – table sur une baisse des usages numériques, et une diminution de fait de son empreinte, via une interdiction de certains usages comme l’affichage publicitaire DOOH (Digital Out Of Home) et le recours à des réseaux informatiques locaux plutôt qu’à une infrastructure planétaire systématique.
À QUEL SCÉNARIO S’ADAPTENT NOS USAGES ?
Nombreuses ont été les illustrations de ces différents scénarios lors de la journée de conférence Ethics by Design. Au nombre des intervenants, citons notamment Delphine Gross, coordinatrice commerciale de la coopérative d’électronique responsable Commown [1]. Dans son analyse du marché de la téléphonie, elle parcourt ainsi les offres et initiatives de différents acteurs à l’aune des scénarios imaginés par l’ADEME. Ainsi, un acteur comme Fairphone, produisant des smartphones Android équitables, durables et réparables, entre pour elle dans le scénario n°3 (Technologies vertes), mettant l’accent sur l’écoconception mais restant sur un modèle de vente de terminaux téléphoniques individuels [1]. Fairphone, fait-elle remarquer, utilise des codes commerciaux proches de ceux de Samsung, Apple et d’autres fabricants : évolution de gamme, mise en avant du Black Friday, etc. même si le rythme de renouvellement de la gamme et l’éventail de gamme est bien moindre que chez ses concurrents américains ou coréens [1].
TeleCoop, opérateur téléphonique coopératif, entre lui dans le scénario n°2 (Coopérations territoriales) en proposant des forfaits sans engagement, mais surtout à consommation data limitée et indexés sur un usage réel – là où les opérateurs historiques proposent aujourd’hui des forfaits illimités poussant à la consommation. Rappel est fait au passage que la connexion de son smartphone sur le Wifi du domicile ou du bureau sera toujours moins consommateur en ressource qu’une connexion 4G. Un opérateur comme TeleCoop ne s’attaque toutefois pas au problème du matériel qui reste l’impact environnemental principal du secteur numérique. Poussant enfin un dernier exemple, Delphine Gross présente la démarche de Commown, opérateur téléphonique au sein duquel elle opère, qui propose la location de ses terminaux Fairphones [1]. Ce qui permet un réemploi de ceux-ci en fin d’abonnement et une gestion de parc raisonnée : les besoins de chaque utilisateur étant différents, certains nouveaux abonnés ont en effet des usages correspondant aux appareils délaissés par d’autres. Ce qui permet également une politique de gestion du matériel plus responsable : l’Arcep estimé en juin 2024 qu’un quart de nos équipements électroniques dormait dans un placard.
Lors d’une autre conférence, Barbara Van Dyck – chercheuse en agroécologie politiques à l’Université de Libre de Bruxelles – se penchait elle sur les liens grandissants entre technologie et agriculture, dénonçant notamment les contradictions entre les pactes verts et la nécessité souvent clamée en haut lieu d’intégrer et d’user du numérique – parfois à outrance – pour contrôler, optimiser la production agro-alimentaire. On intègre ainsi de plus en plus souvent la mesure, voire l’intelligence artificielle, dans les outils utilisés par les agriculteurs – les tracteurs sont désormais des ordinateurs sur roues, quand ils ne se transforment pas simplement en drones – et en même temps, les technologiques numériques accaparent de plus en plus de terres et d’eaux pour la construction et l’opération des datacenters hébergeant ces mêmes intelligences artificielles. La dépendance à la tech augmente – les syndicats américains d’agriculteurs se battent par exemple pour le right to repair – et les agriculteurs se transforment peu à peu en un genre de farmonautes. Un rôle digne du scénario 4 (Pari réparateur) de l’ADEME.
ARRÊTER DE SE RACONTER DES HISTOIRES
Mais peut-être que le véritable questionnement de la journée a finalement été initié par Bastien Marchand, doctorant en redirection écologique, dès la seconde intervention de la journée. Lors d’une conférence intitulé Critique de l'hégémonie des futurs souhaitables, il s’est en effet posé plusieurs questions quant au besoin qu’ont les designers, les prospectivistes et pas mal de professionnels du numérique de "créer des futurs". Manquons-nous réellement de futurs souhaitables ? Faut-il d’abord imaginer avant de concrétiser ? La souhaitabilité aide-t-elle à se mettre en action ?
Des questionnements qui révèlent aussi bien notre difficulté, collective, à passer à l’action que notre besoin constant de positif, d’optimisme, dans un monde où les raisons de se réjouir sont actuellement assez peu nombreuses.
Ces questions sont restées dans la tête de nombreux participants tout au long de la journée. Ainsi, lors d’une intervention conjointe, Jérémie Vallet (Directeur adjoint à la Direction Interministérielle du Numérique – DINUM) et Virginie Rozière (Directrice du numérique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères) rappelaient l’hégémonie actuelle des narratifs techno-optimistes, se rapprochant du scénario n°4 (Pari réparateur) de l’ADEME, prônant la résolution de la crise environnementale par la technologie et influençant actuellement fortement des décideurs. L’influence d’Elon Musk sur l’élection présidentielle américaine étant une preuve supplémentaire, s’il en était besoin, de cet impact. Face à ces imaginaires technophiles, disent-ils, il y a besoin de proposer des solutions alternatives, ancrées dans la réalité des moyens à notre disposition et dans… des imaginaires souhaitables. Christel Fauché – chercheuse en redirection écologique chez b<>com – rappelait de son côté la nécessité d’enlever son côté magique à la technologie et d’assumer ses effets indésirables, comme l’effet rebond (ou le paradoxe de Jevons), le flou dans la définition des objectifs écologiques ou les concurrences d’usage induits par l’innovation.
En fait, en passant en revue l’ensemble de leur journée, les participants à cette première partie d’Ethics by Design ont peut-être eu l’impression d’avoir naviguer au sein d’une bulle. Une bulle de scénario tout d’abord : alors que les imaginaires majoritaires du monde semblent bel et bien pencher pour le scénario n°4 (Pari réparateur) de l’ADEME, la majorité des acteurs de cette journée ne cachaient pas leur préférence pour le scénario n°1 (Génération frugale), voire pour un scénario n°0 plus radical encore imaginé par quelques participants lors d’un atelier de création mené par le studio Ctrl S. Une bulle démographique également, la représentativité de l’audience étant à plusieurs reprises évoquée. Bastien Marchand posait d’ailleurs la question lors de sa séquence introductive évoquée plus haut : les futurs souhaitables ne sont-ils pas des futurs tyranniques ? Quelle est finalement la valeur, pour la majorité des terriens, de scénarios prospectifs imaginés par quelques cadres blancs CSP+ dans leurs bureaux occidentaux ? Le débat reste ouvert.
Comme une provocation, un atelier questionnait lui aussi : Faut-il arrêter les ateliers de design fiction sur les futurs désirables ? Le débat a bien entendu fait rage, porté par divers arguments comme, encore, la représentativité toute relative du monde du design ou la nécessité de rendre accessible au plus grand nombre des contre-imaginaires souhaitables.
Mais au-delà même des scénarios, ce qui ressort de cette journée, c’est finalement l’urgence d’agir plus encore que de raconter. Et même s’il peut paraître important de rappeler que si sans imagination le monde n’est rien, l’important reste la mise en place d’initiatives réelles et tangibles, même de portée locale, pour rendre concrets et mobiliser autour des différents futurs proposés.
Un appel aux designers et à tous les professionnels du numériques à aller plus loin que le dessin de futurs souhaitables : la création des présents positifs !
[1] edit du 02/12/2024 : quelques correctifs et nuances ont été apportés à l’article suite à des précisions de Commown quant au périmètre de son métier et aux caractéristiques de certains acteurs alternatifs de la téléphonie.